La soirée de l’EPS aborde la question de quelle gym à l’école en EPS.
Dans les années 1970, les professeur·es d’EPS étaient souvent appelé·es « profs de gym ». Les vidéos des séances de l’époque témoignent d’une gymnastique axée sur le maintien et la souplesse, avec de grands exercices collectifs. Faire de la gym relevait alors davantage d’une recherche de redressement corporel ou de préparation physique générale que de la quête d’un exploit acrobatique.
Aujourd’hui, la gymnastique scolaire peut être acrobatique, artistique ou rythmique. Elle se trouve au cœur d’une tension entre exploit et maîtrise, entre prise de risque et gestion du risque. Mais la gym évolue aussi, devenant hybride et adoptant d’autres formes : on voit ainsi apparaître l’acrosport, le parkour… Est-ce une évolution ou un contournement ? Modernité, hypermodernité, ou tradition ?
Mais plus fondamentalement, qu’apprennent les élèves aujourd’hui ? Qu’est-ce que la gymnastique représente actuellement ? À haut niveau, quelles sont ses principales évolutions ? Et la gym moderne continue-t-elle de « tourner et voler » vers des exploits toujours plus extraordinaires ?
Nous allons explorer toutes ces questions ce soir, avec des invité·es qui partageront leur vision d’une gymnastique qui devrait retrouver toute sa place dans les programmations d’EPS. Apprendre à tourner ou à tenir en équilibre sur les mains ne devrait-il pas avoir la même importance que savoir nager ou rouler ? Ces compétences, ne constituent-elles pas des clés d’entrée vers de nombreux sports et arts ?
Nos deux premiers invités, Marianne Assadi, juge officielle internationale, et Benoit Lasnier, IPR dans l’académie de Créteil, partagent leurs regards sur la gym aujourd’hui. Son évolution dans les compétitions et sa programmation en EPS.
Plusieurs enseignant·es d’EPS proposent leur entrée dans la gym et la façon dont elles·ils gèrent la tension entre l’acrobatie et la maîtrise.
Marianne Assadi, juge officielle internationale
Apprentissages spécifiques en gymnastique : des appuis manuels aux acrobaties
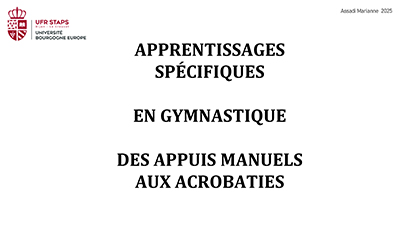
Marie Janicot, prof d’EPS dans l’académie de Dijon
Marie Janicot propose une approche novatrice de la gymnastique en EPS au lycée, alliant acrobatie et gestion des risques pour enrichir l’expérience des élèves. Elle propose une pratique collective inspirée de la Team Gym. Les séances mêlent bases techniques (culbuto, ATR, roue) et travail en ateliers pour développer maîtrise corporelle et progression individuelle.
Mélanie Peltier, prof d’EPS dans l’académie de Versailles
Mélanie Peltier enseigne la gymnastique au collège dans une salle équipée d’agrès. Son approche repose sur des cycles longs (10 séances) permettant à ses élèves, filles et garçons, de maîtriser des enchaînements simples sur quatre agrès : sol, saut, poutre et barre.
Elle structure ses leçons autour des rotations (avant, arrière, longitudinales), des renversements et des franchissements, favorisant une progression sécurisée et la mémorisation des gestes. À travers ces exercices, Mélanie valorise la concentration, l’acceptation du regard des autres et la construction de repères corporels. L’évaluation repose sur une accumulation de points selon des critères précis, incitant à l’effort progressif et à la réussite.
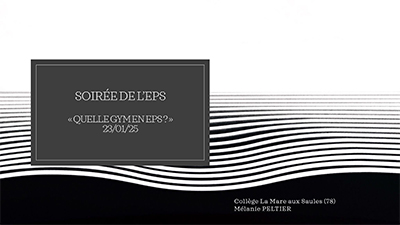
La gymnastique en EPS : un panorama dans l’académie de Créteil avec Benoît Lasnier, IPR
La gymnastique, longtemps au cœur des programmations d’EPS, est aujourd’hui confrontée à une réalité fluctuante, comme le révèle Benoît Lasnier, Inspecteur Pédagogique Régional (IPR) de l’académie de Créteil. Avec des données précises remontant à 2018, il dresse un état des lieux contrasté de cette discipline dans une des plus grandes académies de France.
Une baisse relative de la gymnastique
Depuis 2018, on observe une légère baisse de la programmation de la gymnastique, particulièrement marquée au lycée. Au collège, elle reste relativement stable, représentant environ 5,4 % des cycles en 2018 contre 5 % en 2024. Cependant, la situation est plus préoccupante au lycée, où cette activité est passée de 2,1 % à 1,5 %. Cette diminution s’explique en partie par la difficulté de planifier des cycles d’activités acrobatiques, notamment en classe de seconde, où les enseignant·es privilégient souvent l’acrosport et la danse dans le cadre du processus de création artistique.
Des contraintes matérielles et pédagogiques
Les défis matériels jouent également un rôle clé. Avec des équipements parfois limités, comme une seule barre parallèle pour une classe entière, les enseignant·es sont confronté·es à des choix difficiles. Les contraintes pédagogiques, notamment le manque de formation technique en gymnastique, amplifient ces difficultés. Les enseignant·es peuvent manquer de confiance face à la complexité technique de cette activité et à la gestion des risques associés, ce qui les pousse à privilégier des activités perçues comme plus accessibles.
Une évolution des pratiques et des attentes
Si la gymnastique au sol reste la norme, avec des ateliers centrés sur des compétences de base comme les équilibres ou les rotations simples, l’enchaînement acrobatique est moins programmé. Par ailleurs, des activités comme l’acrosport ou les arts du cirque viennent souvent remplacer la gymnastique classique en quatrième ou troisième.
Une gymnastique qui évolue, mais reste pertinente
Malgré ces évolutions, la gymnastique conserve une pertinence dans les programmes d’EPS. Elle développe des compétences motrices fondamentales, comme le gainage, l’équilibre ou la gestion du risque. De plus, l’acrobatie reste très présente dans la culture des jeunes, comme le montre leur engouement pour des pratiques libres dans des structures privées ou des vidéos impressionnantes sur les réseaux sociaux.
En conclusion, la gymnastique scolaire traverse une période de transition, confrontée à des défis structurels et pédagogiques. Pour Benoît Lasnier, il est essentiel de réfléchir à des solutions pour renforcer sa place dans les programmations, en valorisant son apport unique et en soutenant les enseignant·es dans leur pratique.
Lire le bilan de la soirée
Le kiosque
L’école de Barbiana, lettre à une enseignante
Aux Éditions Agone, 2022
Par Bruno Cremonesi

Les élèves d’une ville en Italie, Barbiana, accompagnés de leur professeur Don Lorenzo Milani, écrivent une lettre à leurs enseignantes. Ce courrier des enfants exclus de l’école italienne dans les années 60 invite à une réflexion critique sur l’école publique. Une école publique qui, encore aujourd’hui, laisse sur le bord du chemin d’acquisition d’une culture ambitieuse nombre d’enfants, principalement issus des milieux populaires. La France fait partie des pays en Europe qui accentuent les inégalités. Les dernières réformes de l’école, à la fois le lycée professionnel, le lycée, mais plus récemment, les classes de niveaux, n’ont fait qu’accentuer cet état de fait. Cette republication, encadrée par un texte de Pier Paolo Pasolini et Laurence Decock, vient discuter avec exigence le regard d’une école reproductrice de l’ordre social et notamment la définition des savoirs. Le regard critique de Pasolini sur le projet d’école d’influence selon lui d’un « idéalisme concret » qui cherche à renouer l’expérience scolaire du quotidien des élèves en minorant la culture qualifiée de petite bourgeoise. Une tension passionnante qui vient questionner le projet politique d’une école émancipatrice pour tous et toutes, qui ne pourra se faire en ignorant la culture dominante.
Je suis un Citoyen Américain / Wong Kim Ark, aux racines du droit du sol
Martha Brockenbrough, Grace Lin, Julia Kuo, aux éditions Hongfei
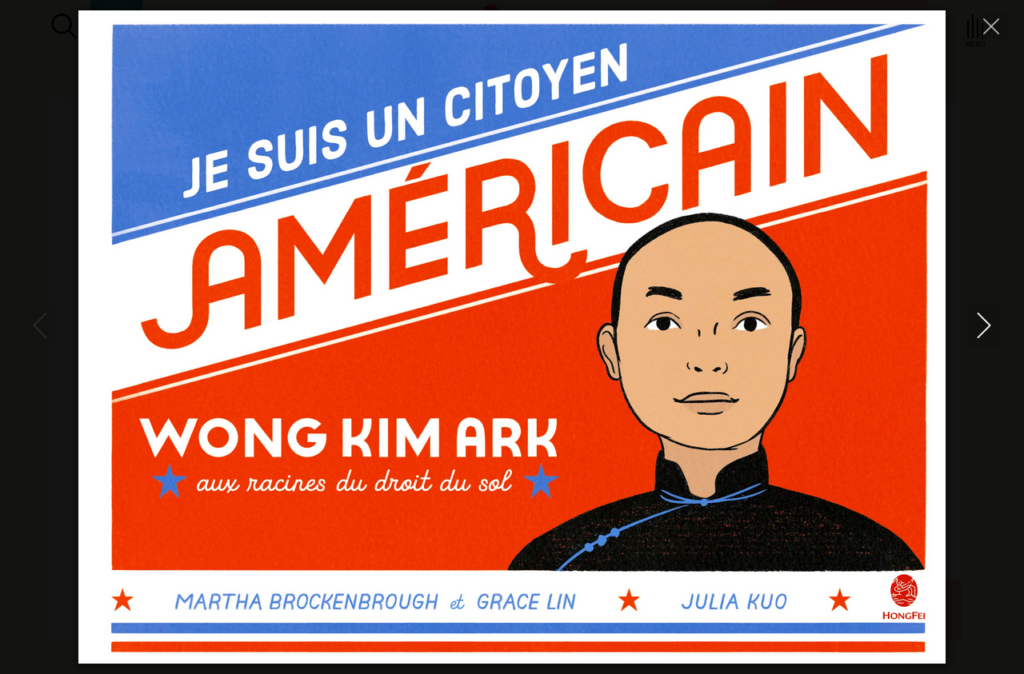
Il y a des livres de littérature jeunesse qui résonnent dans la vie des adultes et dans l’actualité. Ce livre raconte l’histoire de Wong Kim Ark, né dans une famille chinoise de San Francisco en 1873. Lorsque, adulte, on l’emprisonne comme étranger au retour d’un voyage, en lui refusant l’entrée aux USA, il crie à l’injustice, ne comprenant en quoi il ne serait pas Américain. En 1898, la Cour suprême lui donnera raison. Depuis, quiconque naît aux USA acquiert de fait la citoyenneté américaine. Depuis la campagne pour l’élection présidentielle américaine de 2016 et la dernière, la question des enfants nés aux USA d’étrangers sans papiers, s’est reposée. Mais au-delà des États-Unis, elles se posent en France sur l’accès à la nationalité. Deux doubles-pages documentaires complètent l’album en revenant sur le contexte et l’affaire ainsi que sur la situation en France. Un livre au moins autant politique que de jeunesse.





